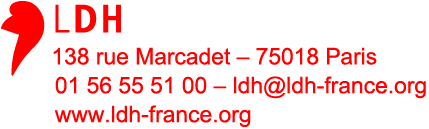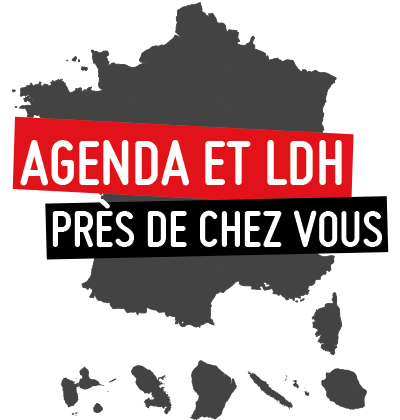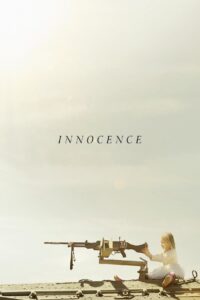
Un film israélien de Guy Davidi (connu pour le film Cinq Caméras brisées, nommé aux Oscars en 2013 et réalisé avec Ernad Burat, paysan palestinien).
Le film raconte l’histoire de plusieurs jeunes enrôlés dans l’armée israélienne qui se sont suicidés pendant leur service. Il entrelace les récits et interviews des familles de cinq de ces jeunes soldats, des scènes d’enseignement dans une école primaire proche de Gaza, des matériaux trouvés sur Youtube et des films de soldats autorisés par l’armée car servant sa propagande. Le réalisateur a aussi consulté et utilisé les archives militaires. Il explique avoir avoir voulu « parler de l’enfance et de l’armée, relier ces deux époques. Dans les parties sur l’enfance, on voit à la fois l’éducation israélienne à l’œuvre, et la peur sensible des enfants. Il est important pour moi de casser l’image très israélienne d’une armée populaire, de réduire l’image de l’homme fort dans la société israélienne ».
Pour faire ce film, Guy Davidi a travaillé une dizaine d’années à la recherche de ces cas de suicides. Il en a identifié environ 700, pour l’écrasante majorité survenus à partir des années 80, et est entré en contact avec une cinquantaine de familles. La rencontre avec certaines familles de droite a été plus difficile. En effet, il explique que celles-ci ont « honte de parler de suicide. L’armée occupe une place fondamentale dans la structure de la société. Elle est censée faire du bien aux jeunes enrôlés, faire d’eux des hommes ou des femmes ».
En définissant ces morts comme accidentelles, ou comme suicides liés à des problèmes extérieurs à l’armée, cette dernière échappe à l’obligation d’aider les familles endeuillées. Les procès intentés par certaines de ces familles ont fait apparaître l’importance de la détention d’arme par les victimes. Dans l’écrasante majorité des cas, en effet, c’est par l’usage de l’arme de service que ces jeunes ont mis fin à leurs jours.
Le film est destiné à un public israélien ; la projection auprès d’un public français ignorant la place centrale qu’occupe l’armée dans la société israélienne et dans la construction des individus (le service militaire est obligatoire, sauf en cas d’inaptitude physique ou mentale, et représente une réelle expérience sociale et patriotique) mérite un accompagnement ; il est difficile, sinon, de comprendre comment des jeunes gens, filles et garçons, acceptent l’enrôlement, même s’ils sont opposés à l’idée de faire la guerre. L’un de ces jeunes, notamment, était un militant opposé à la colonisation, très engagé dans la dénonciation de la politique israélienne.
Le réalisateur lui-même explique comment, après son enrôlement, il lui a été extrêmement difficile d’être libéré. Guy Davidi vit aujourd’hui au Danemark.