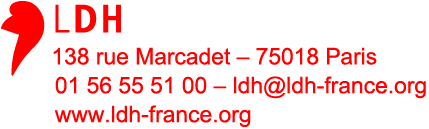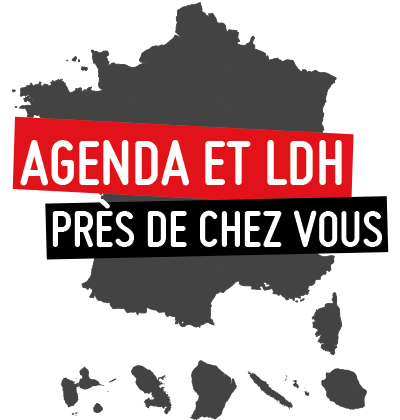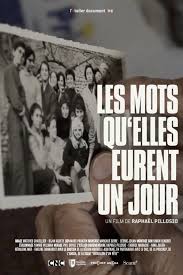
Sortie le 11 juin 2025
En 1962, le cinéaste militant Yann Le Masson (1930-2012) avait filmé une vingtaine de militantes algériennes à leur sortie de la prison de Rennes, avant qu’elles ne soient renvoyées dans leur pays. Ces femmes, qui avaient participé à la révolution en tant porteuses de bombes ou agents de liaison, avaient été arrêtées en Algérie, pour certaines condamnées à mort, et incarcérées en France. Yann Le Masson et la photographe Michèle Fink souhaitaient les interroger sur leur statut de femmes dans la lutte : « Vous, femmes algériennes, qui comme les hommes avez participé à la révolution, qui comme les hommes avez été torturées, que pensez-vous des incidences de ce combat sur le sort de la femme algérienne ? » La discussion avait duré toute une nuit. En 2000, lorsque Yann Le Masson retrouve les bobines de ce tournage, la bande son a disparu. Le réalisateur décide alors de retrouver les protagonistes, mais il n’a plus la force de réaliser son projet et demande à Raphaël Pillosio de prendre la relève.
Yann Le Masson était un opérateur de talent. Le document retrouvé, filmé en noir et blanc, est d’une grande force : les visages de ces femmes sont graves ; elles regardent parfois la caméra qui est très proche dans ce petit appartement prêté par la Cimade où elles sont serrées les unes contre les autres : elles nous regardent.
Pour redonner une voix à ces visages, Raphaël Pillosio se rend en Algérie, mais cinquante ans plus tard, certaines de ces femmes sont mortes, d’autres ne souhaitent pas réveiller cette période dans leur mémoire. L’une de celles qui acceptent de témoigner, Zohra Drif, devenue avocate, considère que, si les femmes ont été mises de côté à l’indépendance, c’est qu’elles ont fait le choix de créer un foyer et de ne pas continuer à faire de la politique. Les visages des femmes filmées en 1962, montés en contrepoint, contredisent silencieusement cette version.
Malika Ouzegane, ex-journaliste devenue opticienne, se souvient qu’au retour d’Algérie, les « filles » étaient décidées à vivre la vie qu’elles voulaient mener, mais que les militants n’avaient pas envie de partager le pouvoir : « Elles n’étaient plus des compagnes de lutte, elles sont devenues des épouses. Les hommes ont tout fait pour faire barrage aux jeunes femmes à ce moment-là ».
Baia Ossine avait 17 ans lors de son arrestation. Dans les années 1990, interrogée par un journaliste, elle déclarait : « vous savez, en 1962, c’est le grand trou, le trou noir. Avant c’était l’aventure. Et puis je me suis retrouvée seule. Je ne sais pas comment cela s’est passé pour les autres sœurs. En prison, on a tellement l’impression que quand on sortira, il y aura les grands frères, on fera une Algérie socialiste. Et puis on voit une Algérie qui s’est faite sans nous. En 1962 les barrières se sont mises en place de manière terrible ».
Une tentative de reconstituer le son avec des interprètes lisant sur les lèvres n’aboutit pas. Restent ces visages silencieux qui nous rappellent avec force ce que ces femmes ont subi en tant qu’Algériennes pendant la guerre, puis en tant que femmes après l’indépendance.
Réalisation : Raphaël Pillosio
Production et distribution : L’Atelier documentaire
Durée : 1h24